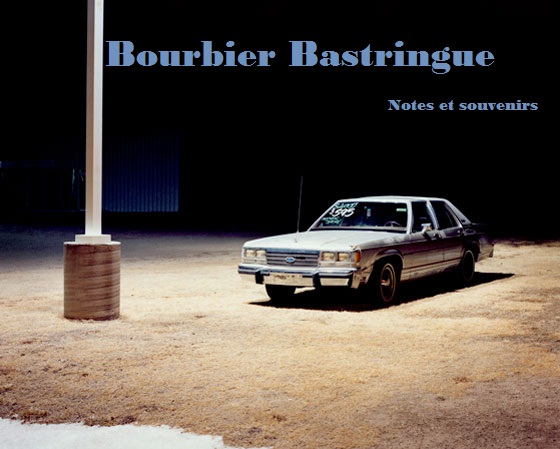le dimanche, les choses sont plus claires. parfois il est possible de se contenter d'être là. d'apprécier ce qui est. se satisfaire d'un constat que l'on ne jugera pas. l'effroi glacé ne glissera plus le long de la colonne vertébrale. rester immobile, encore, mais pour de bonnes raisons. se contenter d'être là.
j'essaye de me poser les bonnes questions, pour le simple plaisir d'apposer des réponses que je connais déjà. ça flatte l'égo de se croire lucide et clairvoyant. ça aide à tenir le choc. le tremblement de terre. être là immobile au dernier niveau d'un parking d'hypermarché, désert. slalomer en vélo entre les abris à charriots et les lampadaires majestueux. le seul moment où la solitude est agréable. apercevoir les voitures qui s'engagent sur l'autoroute, derrière le pont, derrière les panneaux de publicités, derrière derrière derrière. des voitures il y en a peu. le vent a droit de parole. le frisson ne vient plus du vide intérieur, c'est juste l'automne qui murmure son arrivée et qui te réconforte. l'automne dit "tu es vivant, tu sens?" "tu as froid, c'est bon signe, ouvre cette bière que ta pudeur cache dans ton manteau et célébrez ça ensemble. c'est toi le roi". j'ai répondu à l'automne "je t'aime". j'avais envie de pleurer. petit garçon sage. idiot. possédé, ou désirant l'être, ça revient au même en fait. j'ai cru comprendre qu'ici, être n'était ni suffisant, ni nécessaire. on peut se contenter de paraître sublime pour le devenir. c'est ce que j'ai deviné quand le type a démarré en trombe au feu, vendredi dernier, dans sa belle voiture rouge, puissante, celle qui va plus vite que les autres. quand cette fille laissait sa jupe danser dans le vent, rue piétonne, fin d'après midi, belle et prétentieuse. appartenir à quelque chose, si ce n'est pas une question de courage, à quoi ça tient?
je me tenais contre la barrière, contractant les muscles de mon ventre contre elle, légèrement penché, totalement confiant dans le travail de l'architecte et des ouvriers qui firent émerger cette horeur du sol. "si ça lache, j'aurais eu raison de douter de tout". "il n'y a pas de raisons que ça lache". "si ça tient, j'essayerais de prendre plaisir à cracher, et à regarder tomber mon molard quatre étages plus bas, il s'écrasera sur la seule voiture présente, sur le goudron, sur un prospectus qui glisse depuis des heures sur le parking, peut-être mon molard suffira à le stopper. pan, t'es mort". et c'est le monde que j'assassine.
des types avec des guitares il y a des années ont joué une chanson devant des centaines de personnes. ça a été enregistré. ça c'est retrouvé sur des disques et un jourc'est parvenu jusqu'à moi. en ce moment-même, ça coule dans mes oreilles et ça me remplit tout entier. là. ici et maintenant. ça me fait du bien. mais les paroles, je ne me retrouve pas dedans. pourtant, j'aime bien être la voix du chanteur, et la musique, ce sont mes bras devenus des serpents, je deviens un dieu oriental quand j'écoute de la musique. mais là... ça fait trop longtemps que les "you" et les "me" des chansons ne se rapportent plus à rien. avant, ça donnait quelque chose comme "cette chanson est pour toi et voilà ce que je voulais te dire, voilà ce que je partage avec toi". désormais, je reste silencieux et j'imagine. j'écris des nouvelles avec des types qui me ressemblent, d'autres qui seraient mes amis, et des filles qu'on pourrait aimer si elles existaient. j'invente un quotidien qui n'arrivera jamais parce que c'est la seule façon que j'ai trouvé pour ne pas devenir fou. Swallowtail recommence. je fais du vélo, je bois une bière, je pleure. petit garçon sage. idiot. possédé.
*
demain, j'écrirais quelque chose de joyeux, parce que la joie est encore là à rôder quelque part. je ne suis pas triste à mourir. juste très chiant à ne faire que me plaindre. demain, je te ferais rire, et tu te diras "eh, ce type est incroyable".
*
The Brian Jonestown Massacre - Swallowtail (live)
Kwotofzewik le jeune huron cite :
Genius goes around the world in its youth incessantly apologizing for having large feet. What wonder that later in life it should be inclined to raise those feet too swiftly to fools and bores.
F. Scott Fitzgerald
F. Scott Fitzgerald
19.10.10
16.10.10
Quelques étoiles sur mon lit
J'ai croisé une vieille folle dans la rue ; elle hurlait ASSEDIC ; elle gueulait DE LA BOUFFE ; elle criait RENDEZ-MOI MES ENFANTS. Je suis passé à côté d'elle en souriant. Chacun sa merde. Et la pitié était aussi désagréable qu'un caillou dans la chaussure.
J'avais mon casque sur les oreilles. Mazzy Star. J'étais légère comme une plume.
Je me foutais de tout.
Ne pensais qu'à la gorgée de whisky qui m'attendait au bout du chemin.
Toits lumineux, enseignes rouges. Un conducteur m'a laissé traverser. Je lui ai lancé un sourire. Il me l'a rendu et ça m'a rendu un peu plus heureuse.
Vivante.
Consciente du charme que je dégageais, malgré ma gueule marquée et mon haleine de chien.
Toits lumineux, enseignes rouges. Je suis chez moi. Je tourne autour de la table de la cuisine. De plus en plus vite. Sans penser à rien. Et puis je m'assoie, j'attrape la teille et bois longuement, langoureusement, sans me soucier de la brûlure. L'auto-destruction? Une manière d'être sexy, même en enfer.
Une école maternelle en face de chez moi. Innocence aigüe. Le raclement des tricycles. La course désordonnée des mioches, avec leurs mains qui s'agitent et l'instabilité de leurs guibolles. En voilà déjà un qui s'écroule. Pleure. Réclame sans doute le bisou qui guérit tout.
Haha.
Je déteste les gosses. Et si ton genou saigne, petite merde, dis-toi que moi c'est par le cul que le sang s'écoule en ce moment.
Une autre gorgée.
Une autre cigarette.
Je repense à ce type qui m'a laissé traverser tout à l'heure. Un saint, sans doute. Je repense à la vieille folle. Une sainte. Les étoiles se font belles car elles savent qu'elles sont des stars. N'en déplaise aux amoureux. Qui croient encore à l'intégrité de leurs Orions.
Aujourd'hui seuls les oignons me font pleurer.
Je descends ma bouteille pour ne pas descendre mes parents.
Et les pellicules, sur mes draps bleu marine, font comme des étoiles. Voilà ma seule vison de la Beauté. Voilà ma poésie.
J'avais mon casque sur les oreilles. Mazzy Star. J'étais légère comme une plume.
Je me foutais de tout.
Ne pensais qu'à la gorgée de whisky qui m'attendait au bout du chemin.
Toits lumineux, enseignes rouges. Un conducteur m'a laissé traverser. Je lui ai lancé un sourire. Il me l'a rendu et ça m'a rendu un peu plus heureuse.
Vivante.
Consciente du charme que je dégageais, malgré ma gueule marquée et mon haleine de chien.
Toits lumineux, enseignes rouges. Je suis chez moi. Je tourne autour de la table de la cuisine. De plus en plus vite. Sans penser à rien. Et puis je m'assoie, j'attrape la teille et bois longuement, langoureusement, sans me soucier de la brûlure. L'auto-destruction? Une manière d'être sexy, même en enfer.
Une école maternelle en face de chez moi. Innocence aigüe. Le raclement des tricycles. La course désordonnée des mioches, avec leurs mains qui s'agitent et l'instabilité de leurs guibolles. En voilà déjà un qui s'écroule. Pleure. Réclame sans doute le bisou qui guérit tout.
Haha.
Je déteste les gosses. Et si ton genou saigne, petite merde, dis-toi que moi c'est par le cul que le sang s'écoule en ce moment.
Une autre gorgée.
Une autre cigarette.
Je repense à ce type qui m'a laissé traverser tout à l'heure. Un saint, sans doute. Je repense à la vieille folle. Une sainte. Les étoiles se font belles car elles savent qu'elles sont des stars. N'en déplaise aux amoureux. Qui croient encore à l'intégrité de leurs Orions.
Aujourd'hui seuls les oignons me font pleurer.
Je descends ma bouteille pour ne pas descendre mes parents.
Et les pellicules, sur mes draps bleu marine, font comme des étoiles. Voilà ma seule vison de la Beauté. Voilà ma poésie.
Fauteuil en cuir
FAUTEUIL EN CUIR
Fauteuil en cuir
Appartement puant le renfermé
Pluie
Lumière faiblarde et crachotant des ombres pâles
Tristesse enfin
Ma solitude au galop dans une envie de pleurer
Je fume et pense et m'enfuis
J'ai Demande à la Poussière au fond du crâne
Sacré Fante
Toujours la bonne parole
Toujours ta main posée sur mon épaule quand je me rends compte à quel point il fait nuit
Et que je n'y peux rien
Quelques lignes et c'est soleil pour tous
Los Angeles
Grâce à toi j'ai vu Los Angeles
J'ai connu ce chien de Bandini
-homme explosif et petit grand écrivain
J'ai senti le rouge creuser les montagnes et le visage des fous
J'ai
Tout contre moi la peau noircie de Camilla
Sa démarche en plein cœur
Lèvres épaisses
Regard éprouvant
Noir
Bandini qui ne bande plus parce qu'il a peur d'elle
Parce qu'il a peur de toutes les femmes et qu'il est comme toi
Et moi
Et tous les Hommes qui ressentent le besoin de justifier l'échec
En écrivant
Poème de Pierre Anselmet
Fauteuil en cuir
Appartement puant le renfermé
Pluie
Lumière faiblarde et crachotant des ombres pâles
Tristesse enfin
Ma solitude au galop dans une envie de pleurer
Je fume et pense et m'enfuis
J'ai Demande à la Poussière au fond du crâne
Sacré Fante
Toujours la bonne parole
Toujours ta main posée sur mon épaule quand je me rends compte à quel point il fait nuit
Et que je n'y peux rien
Quelques lignes et c'est soleil pour tous
Los Angeles
Grâce à toi j'ai vu Los Angeles
J'ai connu ce chien de Bandini
-homme explosif et petit grand écrivain
J'ai senti le rouge creuser les montagnes et le visage des fous
J'ai
Tout contre moi la peau noircie de Camilla
Sa démarche en plein cœur
Lèvres épaisses
Regard éprouvant
Noir
Bandini qui ne bande plus parce qu'il a peur d'elle
Parce qu'il a peur de toutes les femmes et qu'il est comme toi
Et moi
Et tous les Hommes qui ressentent le besoin de justifier l'échec
En écrivant
Poème de Pierre Anselmet
7.10.10
day and night, that great white zombie.
rares sont les souvenirs qui ne m'évoquent aucune peine, aucune douleur. habitué à vivre à la façon de ces ratés flamboyants (souviens toi de meursault) avant même d'en apprendre l'existence. j'ai passé tellement de temps à jouer à dieu, à déshabiller les filles, à conduire des voitures américaines, à faire la fierté et la joie de mes parents, allongé dans mon lit, attendant que le jour se lève, fuyant le sommeil comme la mort. quand il s'était emparé de moi enfin, tendre et magnifique -tu n'imagines pas tout ce que j'ai vu en lui, ô combien la vie était belle- je ne voulais pas le quitter, la lumière me terrifiait je restais prostré derrière mes volets clos à me demander ce qu'il se passait dehors, de quelle façon je pouvais sortir sans peur, et reprendre le cours des choses. je me suis toujours vu comme un incapable, et c'est sûrement ce que je suis. mais si j'avais la possibilité de faire sortir les orages dans mon crâne tu ne reconnaitrais plus ta ville, et tu m'y retrouverais, triomphant, un sourire magnifique pour seule arme. un écrivain doit bien pouvoir changer les choses, à quoi lui serviraient ses pouvoirs sinon? j'attends le courage comme un miracle. il ne tient qu'à moi de prendre le contrôle mais les ennemis sont trop nombreux. du rire moqueur aux larmes de déception, j'ai fais le tour. what's next?
ce matin je me levé suffisament tôt pour profiter de ma journée. je suis sorti dans la rue et j'ai baissé les yeux. je ne savais pas où aller. la chappe de plomb sur les épaules, elle reste bien en place. serait-ce une épreuve ou une fatalité? je ne crois pas à la fatalité, et je ne suis pas courageux.
alors j'ai fais demi-tour, j'ai mis un disque, poussé le volume au maximum, et suis sorti boire un thé noir aux épices dans le jardin. une cigarette. deux cigarettes. la musique s'infiltrait en moi, et des dizaines de visages sont apparus.
j'ai revu la place du village, avec sa fontaine et ses bancs. un vieux promène un chien, il doit être au chômage. deux types passent en skateboard et me font un signe de la main. une voiture de police. une autre voiture de police. un punk. il s'approche de moi et ouvre son sac. deux bières, un joint, un lecteur mp3 et des enceintes portatives. on discute, on se marre, on se confie. ce type me plait. ses amis arrivent avec d'autres bières. je file au dépanneur en acheter moi aussi, et je prends un sandwich. l'après midi est déjà bien avancé et ce soir, elles seront au bar. les jolies étudiantes, leurs amis, les gens que je croise tous les jours depuis des semaines.
le jour commence à tomber, je rentre me changer. je me rase. je passe la main dans mes cheveux en me disant que finalement, je ne suis pas si mal que ça. qu'ici, dans cette ville, je me sens en sécurité. dans l'appartement que franck et anne-marie occupent, il y a des chats. je joue avec eux en attendant l'heure. ne pas arriver trop tôt, pour qu'ils me voient tous débarquer avec le sourire du vainqueur. je parle de peinture avec anne-marie. je parle de musique avec franck. ils passent à table. ça sent plutôt bon, anne-marie est une bonne cuisinière. j'aime beaucoup cette fille, on dirait que quelque part dans l'univers, nous sommes conenctés. nous sommes amis sans avoir besoin de nous le dire. elle a du talent. j'espère qu'elle saura persévérer et ne pas se laisser submerger par la vie qu'elle mène, partagée entre un travail pas très gratifiant, les soucis du quotidien, l'envie d'ailleurs. je lui ai offert le livre qui a changé ma vie. j'espère qu'il lui reste assez de magie pour elle. je les laisse tous les deux, pour une fois que personne d'autre ne hante l'appartement (eux et leur colloctaire m'ont gentimment fait une place parmis eux, étranger perdu à l'autre bout du monde, rien ne laissait présager une rencontre pareille. je suis un membre de leur tribu désormais. naturellement. quelque chose d'évident). en leur souhaitant une bonne soirée j'enfile mon manteau et descend la rue avec fierté : des voitures s'arrêtent pour me saluer, des gens me font signe de la main depuis le trottoir d'en face. "on se voit au bar? -absolument! -super!". je m'arrête pour acheter des cigarettes, et une grosse bouteille de bière. je retourne à ce qu'ils appellent le village. cette petite place où je peux rester des heures sur un banc, à penser et écrire, à regarder les gens et les accueillir sur mon banc. tout le monde me connait ici. je ne me connais aucun ennemis. je n'y ai aucune angoisse. juste l'ennui parfois, mais c'est la banlieue qui veut ça. la banlieue et le gouvernement du canada qui ne me délivrera pas de visa de travail. je suis plein de joie. les filles me trouvent séduisant, les garçons aiment rire avec moi. je danse toute la nuit comme si j'étais bon à ça. je flirte un peu. mon gros coeur de timide prend cher tous les soirs, mais il y a l'alcool. il y a la confiance, il y a leurs sourires. ma honte meurt doucement. je suis un des leurs. rien n'a d'importance. rien ne peut m'atteindre.
au bar, des types m'invitent à faire une partie de billard. que je les connaisse ou non n'a aucune importance. c'est comme ça que ça se passe ici. s'ils me connaissent, ils m'invitent pour poursuivre la découverte naturelle de nous-même. s'ils ne me connaissent pas, c'est parce qu'ils ont envie de remédier à ça. moi j'ai beaucoup de mal à me souvenir de tous les prénoms et de tous les visages. quand je ressors de cet endroit, je suis salement ivre et heureux, et le lendemain il faut faire des efforts pour replacer chaque chose à leur place. c'est le prix à payer, et c'est vraiment pas cher. je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. ma ville ne me manque pas. je repense à ma famille, c'est sûr, à quelques amis, mais dans le fond, si je pouvais ne jamais quitter cet endroit, ce serait parfait. un appartement, un job, une petite amie, une vie simple et tranquille, loin de mes obsessions et de mes peurs. ici je suis qui je suis. personne n'ose dire le contraire. personne ne se moque, personne ne me juge. je suis heureux.
après le billard, il y a les tournées de bières. la serveuse m'aime bien, alors si je n'ai pas assez de monnaie pour laisser du tip, ce n'est pas trop grave. elle sourit et me dit "une prochaine fois". elle me donne des crédits pour aller choisir des chansons au juke-box. parfois je pousse même jusqu'à demander au dj s'il connait tel ou tel groupe, s'il peut mettre cette chanson pour moi. quand ça se goupille bien, on me voit marcher en marquant le beat avec la tête, prenant les gens par les épaules, tanguer, lever le poing et gueuler le refrain. ça ne surprend personne. rien n'a d'importance, rien ne peut m'atteindre. je sais de toute façon que ça ne dérange personne. je suis un héros. et si certains ne m'aiment pas, on fait avec. on s'en fout. ça ne change rien. j'aime ces gens autant qu'ils m'aiment.
après un moment, l'envie de changer d'atmosphère me prend. il suffit de descendre les escalier et de retourner dans la rue. allumer une cigarette. voir si du monde se tient derrière le bar, dans cette espèce de cour, et de fumer sur leur éptard, de rire un peu. des obsénités, des blagues vaseuses, de la franche camaraderie. si certains ne me connaissent pas et me lancent un regard hostile ou plein d'interrogation, je sais que quelqu'un me présentera. il me suffira de tendre la main, de sourire, et de parler. les choses sont si simples. puis je traverse la rue, dans un état incroyable, je pourrais être le président des états unis, ou un philosophe, un guerrier. je traverse la rue avec assurance. les flics, s'ils passent à ce moment, ralentissent et me dévisagent, c'est tout. je rentre dans l'autre bar, celui où on danse. celui où il y a des dizaines de jolies filles. celui où on m'accueille avec plaisir. une tournée de bières, une clope sur la terrasse. on me tire par la main versla piste. j'hésite. je sais que j'en ai envie. je sais que c'est la chose à faire. la gêne ne disparait jamais complètement. les choses changent, l'instint reste. je suis toujours ce petit garçon timide et honteux, mais j'ai suffisament d'alcool dans le sang, d'amis et de courage maintenant pour ne pas lacher la main et me mettre à danser. j'ai sûrement l'air ridicule, mais au bout de deux chansons, générallement, c'est oublié. j'ai les yeux fermés. je suis entouré. je fais parti du grand tout. je me baigne dans l'univers. parfois une fille que je ne connais pas me regarde et me souris. les choses sont différentes de ce côté de l'atlantique, mais je n'en abuse pas. je souris timidement et détourne le regard. parfois elles viennent me parler. une fois même, l'une d'elles m'a demandé de l'embrasser. juste parce que j'étais français. j'aurais été idiot de refuser. elle était terriblement belle. je suis l'étranger, mais je suis un des leurs. la soirée se termine. souvent, on me propose de suivre une bande de gens vers une maison où aller se détendre avec quelques derniers verres. c'est généralement calme. on discute de choses passionnantes. politique, art, les différences entre nos deux pays. je suis le bienvenue. je m'endors dans le canapé. le lendemain je reprends mon manteau, salue ceux qui sont déjà debout et quitte la maison.
le thé est froid. le vent s'est levé et je tousse. j'ai de la fièvre. une dent de sagesse pousse. de travers. y'at-il un symbole dans ce fait? dois-je comprendre quelque chose? peut-êbre bien que oui.
je suis oisif. j'ai baissé les bras. je m'en plain mais ne fait pas vraiment grand chose pour changer ça. je ne sais rien faire de toute façon.
je suis dans le jardin de ma mère et mes souvenirs s'éloignent avec les premières feuilles mortes. tant pis. ces souvenirs, ils me servent de béquilles. parce que je sais que quelque part sur terre il y a un endroit où je suis libre et grand. il est vrai que de cette période je n'ai pas fais grand chose de valable, si ce n'est pour moi et moi seul. on ne me l'enlèvera jamais. j'étais ce grand zombie blanc, magnifique état de quiétude. immortel. vous me manquez, sainte-thérèse. puissent vos jours être glorieux et toujours sincères et doux. je reviendrai vous hanter.
ce matin je me levé suffisament tôt pour profiter de ma journée. je suis sorti dans la rue et j'ai baissé les yeux. je ne savais pas où aller. la chappe de plomb sur les épaules, elle reste bien en place. serait-ce une épreuve ou une fatalité? je ne crois pas à la fatalité, et je ne suis pas courageux.
alors j'ai fais demi-tour, j'ai mis un disque, poussé le volume au maximum, et suis sorti boire un thé noir aux épices dans le jardin. une cigarette. deux cigarettes. la musique s'infiltrait en moi, et des dizaines de visages sont apparus.
j'ai revu la place du village, avec sa fontaine et ses bancs. un vieux promène un chien, il doit être au chômage. deux types passent en skateboard et me font un signe de la main. une voiture de police. une autre voiture de police. un punk. il s'approche de moi et ouvre son sac. deux bières, un joint, un lecteur mp3 et des enceintes portatives. on discute, on se marre, on se confie. ce type me plait. ses amis arrivent avec d'autres bières. je file au dépanneur en acheter moi aussi, et je prends un sandwich. l'après midi est déjà bien avancé et ce soir, elles seront au bar. les jolies étudiantes, leurs amis, les gens que je croise tous les jours depuis des semaines.
le jour commence à tomber, je rentre me changer. je me rase. je passe la main dans mes cheveux en me disant que finalement, je ne suis pas si mal que ça. qu'ici, dans cette ville, je me sens en sécurité. dans l'appartement que franck et anne-marie occupent, il y a des chats. je joue avec eux en attendant l'heure. ne pas arriver trop tôt, pour qu'ils me voient tous débarquer avec le sourire du vainqueur. je parle de peinture avec anne-marie. je parle de musique avec franck. ils passent à table. ça sent plutôt bon, anne-marie est une bonne cuisinière. j'aime beaucoup cette fille, on dirait que quelque part dans l'univers, nous sommes conenctés. nous sommes amis sans avoir besoin de nous le dire. elle a du talent. j'espère qu'elle saura persévérer et ne pas se laisser submerger par la vie qu'elle mène, partagée entre un travail pas très gratifiant, les soucis du quotidien, l'envie d'ailleurs. je lui ai offert le livre qui a changé ma vie. j'espère qu'il lui reste assez de magie pour elle. je les laisse tous les deux, pour une fois que personne d'autre ne hante l'appartement (eux et leur colloctaire m'ont gentimment fait une place parmis eux, étranger perdu à l'autre bout du monde, rien ne laissait présager une rencontre pareille. je suis un membre de leur tribu désormais. naturellement. quelque chose d'évident). en leur souhaitant une bonne soirée j'enfile mon manteau et descend la rue avec fierté : des voitures s'arrêtent pour me saluer, des gens me font signe de la main depuis le trottoir d'en face. "on se voit au bar? -absolument! -super!". je m'arrête pour acheter des cigarettes, et une grosse bouteille de bière. je retourne à ce qu'ils appellent le village. cette petite place où je peux rester des heures sur un banc, à penser et écrire, à regarder les gens et les accueillir sur mon banc. tout le monde me connait ici. je ne me connais aucun ennemis. je n'y ai aucune angoisse. juste l'ennui parfois, mais c'est la banlieue qui veut ça. la banlieue et le gouvernement du canada qui ne me délivrera pas de visa de travail. je suis plein de joie. les filles me trouvent séduisant, les garçons aiment rire avec moi. je danse toute la nuit comme si j'étais bon à ça. je flirte un peu. mon gros coeur de timide prend cher tous les soirs, mais il y a l'alcool. il y a la confiance, il y a leurs sourires. ma honte meurt doucement. je suis un des leurs. rien n'a d'importance. rien ne peut m'atteindre.
au bar, des types m'invitent à faire une partie de billard. que je les connaisse ou non n'a aucune importance. c'est comme ça que ça se passe ici. s'ils me connaissent, ils m'invitent pour poursuivre la découverte naturelle de nous-même. s'ils ne me connaissent pas, c'est parce qu'ils ont envie de remédier à ça. moi j'ai beaucoup de mal à me souvenir de tous les prénoms et de tous les visages. quand je ressors de cet endroit, je suis salement ivre et heureux, et le lendemain il faut faire des efforts pour replacer chaque chose à leur place. c'est le prix à payer, et c'est vraiment pas cher. je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. ma ville ne me manque pas. je repense à ma famille, c'est sûr, à quelques amis, mais dans le fond, si je pouvais ne jamais quitter cet endroit, ce serait parfait. un appartement, un job, une petite amie, une vie simple et tranquille, loin de mes obsessions et de mes peurs. ici je suis qui je suis. personne n'ose dire le contraire. personne ne se moque, personne ne me juge. je suis heureux.
après le billard, il y a les tournées de bières. la serveuse m'aime bien, alors si je n'ai pas assez de monnaie pour laisser du tip, ce n'est pas trop grave. elle sourit et me dit "une prochaine fois". elle me donne des crédits pour aller choisir des chansons au juke-box. parfois je pousse même jusqu'à demander au dj s'il connait tel ou tel groupe, s'il peut mettre cette chanson pour moi. quand ça se goupille bien, on me voit marcher en marquant le beat avec la tête, prenant les gens par les épaules, tanguer, lever le poing et gueuler le refrain. ça ne surprend personne. rien n'a d'importance, rien ne peut m'atteindre. je sais de toute façon que ça ne dérange personne. je suis un héros. et si certains ne m'aiment pas, on fait avec. on s'en fout. ça ne change rien. j'aime ces gens autant qu'ils m'aiment.
après un moment, l'envie de changer d'atmosphère me prend. il suffit de descendre les escalier et de retourner dans la rue. allumer une cigarette. voir si du monde se tient derrière le bar, dans cette espèce de cour, et de fumer sur leur éptard, de rire un peu. des obsénités, des blagues vaseuses, de la franche camaraderie. si certains ne me connaissent pas et me lancent un regard hostile ou plein d'interrogation, je sais que quelqu'un me présentera. il me suffira de tendre la main, de sourire, et de parler. les choses sont si simples. puis je traverse la rue, dans un état incroyable, je pourrais être le président des états unis, ou un philosophe, un guerrier. je traverse la rue avec assurance. les flics, s'ils passent à ce moment, ralentissent et me dévisagent, c'est tout. je rentre dans l'autre bar, celui où on danse. celui où il y a des dizaines de jolies filles. celui où on m'accueille avec plaisir. une tournée de bières, une clope sur la terrasse. on me tire par la main versla piste. j'hésite. je sais que j'en ai envie. je sais que c'est la chose à faire. la gêne ne disparait jamais complètement. les choses changent, l'instint reste. je suis toujours ce petit garçon timide et honteux, mais j'ai suffisament d'alcool dans le sang, d'amis et de courage maintenant pour ne pas lacher la main et me mettre à danser. j'ai sûrement l'air ridicule, mais au bout de deux chansons, générallement, c'est oublié. j'ai les yeux fermés. je suis entouré. je fais parti du grand tout. je me baigne dans l'univers. parfois une fille que je ne connais pas me regarde et me souris. les choses sont différentes de ce côté de l'atlantique, mais je n'en abuse pas. je souris timidement et détourne le regard. parfois elles viennent me parler. une fois même, l'une d'elles m'a demandé de l'embrasser. juste parce que j'étais français. j'aurais été idiot de refuser. elle était terriblement belle. je suis l'étranger, mais je suis un des leurs. la soirée se termine. souvent, on me propose de suivre une bande de gens vers une maison où aller se détendre avec quelques derniers verres. c'est généralement calme. on discute de choses passionnantes. politique, art, les différences entre nos deux pays. je suis le bienvenue. je m'endors dans le canapé. le lendemain je reprends mon manteau, salue ceux qui sont déjà debout et quitte la maison.
le thé est froid. le vent s'est levé et je tousse. j'ai de la fièvre. une dent de sagesse pousse. de travers. y'at-il un symbole dans ce fait? dois-je comprendre quelque chose? peut-êbre bien que oui.
je suis oisif. j'ai baissé les bras. je m'en plain mais ne fait pas vraiment grand chose pour changer ça. je ne sais rien faire de toute façon.
je suis dans le jardin de ma mère et mes souvenirs s'éloignent avec les premières feuilles mortes. tant pis. ces souvenirs, ils me servent de béquilles. parce que je sais que quelque part sur terre il y a un endroit où je suis libre et grand. il est vrai que de cette période je n'ai pas fais grand chose de valable, si ce n'est pour moi et moi seul. on ne me l'enlèvera jamais. j'étais ce grand zombie blanc, magnifique état de quiétude. immortel. vous me manquez, sainte-thérèse. puissent vos jours être glorieux et toujours sincères et doux. je reviendrai vous hanter.
5.10.10
Julien
Julien dessinait des mandalas avec des carottes rappées et du vinaigre bio. Il a habité chez moi quelques temps, histoire d'avoir, pour lui, un pied à terre. Et puis il est parti. Et je ne l'ai jamais revu.
Il aimait les femmes et les jardins.
Il parcourait le monde à la recherche de fleurs et de bonheur à partager.
Un jour, son fils de 10 ans lui a donné 20 euros pour qu'il s'achète un baladeur mp3. Il a pris le billet, il a embrassé son fils, et il lui a promit de lui créer le plus beau des jardins.
Une overdose de fleurs et de fruits.
De la musique.
La beauté de Krishna dans le moindre petit brin d'herbe.
Il lui a promit le soleil et les ruisseaux, et la fraîcheur de la terre sous les doigts, et les fées (car Julien croyait aux fées), et la finesse des tissus.
Il lui a promit tout ça en le regardant droit dans le yeux. Il tenait fermement la main de son fils. Son sourire n'en finissait pas. Il s'est mis à fredonner des mantras, des chants inventés, des paroles d'amour universel.
L'instant était magique, assurément.
Mais savait-il que ce petit être chéri avait déjà pitié de lui? qu'à 10 ans, à présent, on ne rêve plus comme à 38? qu'à 38 ans on est presque obligé d'être un père? Un monolithe?
Il aimait les femmes et les jardins.
Il parcourait le monde à la recherche de fleurs et de bonheur à partager.
Un jour, son fils de 10 ans lui a donné 20 euros pour qu'il s'achète un baladeur mp3. Il a pris le billet, il a embrassé son fils, et il lui a promit de lui créer le plus beau des jardins.
Une overdose de fleurs et de fruits.
De la musique.
La beauté de Krishna dans le moindre petit brin d'herbe.
Il lui a promit le soleil et les ruisseaux, et la fraîcheur de la terre sous les doigts, et les fées (car Julien croyait aux fées), et la finesse des tissus.
Il lui a promit tout ça en le regardant droit dans le yeux. Il tenait fermement la main de son fils. Son sourire n'en finissait pas. Il s'est mis à fredonner des mantras, des chants inventés, des paroles d'amour universel.
L'instant était magique, assurément.
Mais savait-il que ce petit être chéri avait déjà pitié de lui? qu'à 10 ans, à présent, on ne rêve plus comme à 38? qu'à 38 ans on est presque obligé d'être un père? Un monolithe?
3.10.10
La pluie, de l'autre côté
La pluie, de l'autre côté de la vitre.
Je bois pour oublier que j'ai oublié d'aller à ce rendez-vous. Un homme parfait, avec
sans doute un bouquet de fleurs
dans les mains et qui,
justement,
m'a offert cette bouteille de vin très cher.
Je repère, dans un coin, un mouton de poussière ; je préfère largement
la poussière aux moutons. C'est une question de liberté. De proximité, presque.
Hier
j'ai sniffé ma dernière ligne de speed. Le chapitre est clos. Aujourd'hui
c'est au goulot que je m'affaire.
Je me sens confortablement vaine, élégamment pocharde et
petite comme
la volonté foireuse des je-m'en-foutistes - des artistes bouffant de la page blanche
à longueur de journée.
Je suis une auteure qui se croit une hauteur infranchissable
Les fleurs embellissent ma poubelle
Et sûr que je suis belle. Oui.
J'ai l'ordure baroque
Je bois pour oublier que j'ai oublié d'aller à ce rendez-vous. Un homme parfait, avec
sans doute un bouquet de fleurs
dans les mains et qui,
justement,
m'a offert cette bouteille de vin très cher.
Je repère, dans un coin, un mouton de poussière ; je préfère largement
la poussière aux moutons. C'est une question de liberté. De proximité, presque.
Hier
j'ai sniffé ma dernière ligne de speed. Le chapitre est clos. Aujourd'hui
c'est au goulot que je m'affaire.
Je me sens confortablement vaine, élégamment pocharde et
petite comme
la volonté foireuse des je-m'en-foutistes - des artistes bouffant de la page blanche
à longueur de journée.
Je suis une auteure qui se croit une hauteur infranchissable
Les fleurs embellissent ma poubelle
Et sûr que je suis belle. Oui.
J'ai l'ordure baroque
2.10.10
LANOITAN EHT
[insert "texte démesurément long et élogieux, écrit avec goût et sensibilité, force détails et une passion indiscutable" here]
americanmary.com
melody of my life.
americanmary.com
melody of my life.
jeune homme moderne, occidental, de classe moyenne.
je ne suis pas parvenu à écrire un seul mot depuis ce fameux samedi noir, quand le mec a saisi la bouteille de vin, alors que je remontai la rue. il l'a saisie et il m'a cogné, mon dos, mon épaule. je rentrais tendrement chez moi, ma seule distraction depuis des semaines, le seul moment agréable, la nuit-mon vélo-un peu de vin-du temps devant moi. j'ai eu peur, j'ai paniqué et j'ai voulu pleurer, j'ai laissé la colère qui me remplissait depuis trop longtemps couler le long de mes joues le long de mon torse, j'ai bluffé. le torse bombé et la mâchoire carnassière j'ai hurlé sur son visage, j'ai fais le fier, j'ai joué la parade. le paon. le désastre.
je me suis roulé en boule sur le bitume et j'ai nommé mon père, j'ai nommé celles que j'ai aimé, j'ai nommé dieu et il n'a pas répondu. j'ai souri. convaincu. pas de nouvelles...
oh depuis le samedi noir je me lève tôt, je prends le café avec maman, je tremble souvent et je me tiens loin de l'alcool, je regarde les gens avec un visage impassible. j'attends. j'ai survécu et c'est pas si mal.
j'ai pris le temps que j'avais, je l'ai passé à lire dostoievski encore, et faulkner et hemingway, j'ai regardé le chat et j'ai récité ses miaulements comme des psaumes. j'ai attendu que quelqu'un sonne à la porte, qu'il me demande de le suivre mais personne n'est venu.
j'ai récité des paragraphes entiers de ma biographie, j'ai chanté des poèmes comme s'ils étaient les plus purs et les plus sincères du monde. j'ai attendu que quelqu'un sonne...
le stylo n'avait pas bougé, le capuchon était toujours tourné vers la droite, vers le bord de la table, le papier était là, le papier a été chiffonné, le papier a été déchiré, le papier a été brûlé, il aura été blanc jusqu'au bout.
j'avais survécu et il fallait que je le raconte. ou plutôt, il fallait que je raconte ce que j'avais à raconter. un truc dans le genre, confus.
peut-être que ça vaut le coup, peut-être que je suis un bon écrivain.
*
en écoutant de la musique une bouteille de vin est venue
danser
devant mes yeux
elle murmurait mon nom
elle disait
"viens, fils, viens
je te consolerai
et tu ne pleureras plus,
tu verras, tu verras"
elle dansait autour de moi j'ai détourné les yeux tu sais. je jouai le jeu de la frustration. j'ai laissé mon corps redevenir jeune et beau. j'ai permis à mon regard de redevenir doux. j'ai permis quelques sourires au miroir. j'ai ri avec maman, on regardait les informations et je râlais pendant les publicités. je parlais. je disais qui j'étais. tout était bien.
j'ai repensé à la fille qui m'avait obsédé pendant si longtemps (je me demande comment elle va, si elle pense à moi parfois), j'ai repensé à celles que je n'ai pas réussi à posséder (celles qui n'ont pas voulu de moi, qui ne sauront jamais à quel point je peux être tendre et gentil). j'ai repensé à la chance. comme on repense à une vieille amie. de la nostalgie fantasmée.
je n'ai jamais eu de chance, à mon niveau. toutes proportions gardées et tout (parce que je ne suis qu'un jeune homme moderne, occidental et de classe moyenne).
la fille qui m'obsèdait, cela fait bien longtemps que je ne suis plus amoureux d'elle, un truc du genre persistance rétinienne, mais dans le coeur, un truc inutile. un jouet pour me distraire quand je me sens seul. torture mentale.
*
finalement on retombe sur un vieux disque, il glisse d'un carton, il finit dans le walkman, il passera la nuit, il survivra à travers le temps, et la voix appartient à un suicidé, et le violon me donne des frisson, et i wish i had a horse's head a tiger's heart an apple bed.
on oublie le pamphlet rageur et plein de bravoure, l'acte ultime de révolte, le texte parfait que l'on n'écrira jamais. dilué dans une chanson, dans un verre d'eau. je pisse depuis le balcon. ça suffit pour me sentir punk. ouais, rien que ça. risible et magnifique. c'est ce que nous sommes tous et c'est ce pour quoi je ne mérite aucun jugement. cela vous exposerait à des vérités que vous préféreriez ne pas entendre à propos de vous même.
[et il reste des tas de fautes et de maladresse, m'en voulez pas mais ça sera pas corrigé tout de suite :D)
je me suis roulé en boule sur le bitume et j'ai nommé mon père, j'ai nommé celles que j'ai aimé, j'ai nommé dieu et il n'a pas répondu. j'ai souri. convaincu. pas de nouvelles...
oh depuis le samedi noir je me lève tôt, je prends le café avec maman, je tremble souvent et je me tiens loin de l'alcool, je regarde les gens avec un visage impassible. j'attends. j'ai survécu et c'est pas si mal.
j'ai pris le temps que j'avais, je l'ai passé à lire dostoievski encore, et faulkner et hemingway, j'ai regardé le chat et j'ai récité ses miaulements comme des psaumes. j'ai attendu que quelqu'un sonne à la porte, qu'il me demande de le suivre mais personne n'est venu.
j'ai récité des paragraphes entiers de ma biographie, j'ai chanté des poèmes comme s'ils étaient les plus purs et les plus sincères du monde. j'ai attendu que quelqu'un sonne...
le stylo n'avait pas bougé, le capuchon était toujours tourné vers la droite, vers le bord de la table, le papier était là, le papier a été chiffonné, le papier a été déchiré, le papier a été brûlé, il aura été blanc jusqu'au bout.
j'avais survécu et il fallait que je le raconte. ou plutôt, il fallait que je raconte ce que j'avais à raconter. un truc dans le genre, confus.
peut-être que ça vaut le coup, peut-être que je suis un bon écrivain.
*
en écoutant de la musique une bouteille de vin est venue
danser
devant mes yeux
elle murmurait mon nom
elle disait
"viens, fils, viens
je te consolerai
et tu ne pleureras plus,
tu verras, tu verras"
elle dansait autour de moi j'ai détourné les yeux tu sais. je jouai le jeu de la frustration. j'ai laissé mon corps redevenir jeune et beau. j'ai permis à mon regard de redevenir doux. j'ai permis quelques sourires au miroir. j'ai ri avec maman, on regardait les informations et je râlais pendant les publicités. je parlais. je disais qui j'étais. tout était bien.
j'ai repensé à la fille qui m'avait obsédé pendant si longtemps (je me demande comment elle va, si elle pense à moi parfois), j'ai repensé à celles que je n'ai pas réussi à posséder (celles qui n'ont pas voulu de moi, qui ne sauront jamais à quel point je peux être tendre et gentil). j'ai repensé à la chance. comme on repense à une vieille amie. de la nostalgie fantasmée.
je n'ai jamais eu de chance, à mon niveau. toutes proportions gardées et tout (parce que je ne suis qu'un jeune homme moderne, occidental et de classe moyenne).
la fille qui m'obsèdait, cela fait bien longtemps que je ne suis plus amoureux d'elle, un truc du genre persistance rétinienne, mais dans le coeur, un truc inutile. un jouet pour me distraire quand je me sens seul. torture mentale.
*
finalement on retombe sur un vieux disque, il glisse d'un carton, il finit dans le walkman, il passera la nuit, il survivra à travers le temps, et la voix appartient à un suicidé, et le violon me donne des frisson, et i wish i had a horse's head a tiger's heart an apple bed.
on oublie le pamphlet rageur et plein de bravoure, l'acte ultime de révolte, le texte parfait que l'on n'écrira jamais. dilué dans une chanson, dans un verre d'eau. je pisse depuis le balcon. ça suffit pour me sentir punk. ouais, rien que ça. risible et magnifique. c'est ce que nous sommes tous et c'est ce pour quoi je ne mérite aucun jugement. cela vous exposerait à des vérités que vous préféreriez ne pas entendre à propos de vous même.
[et il reste des tas de fautes et de maladresse, m'en voulez pas mais ça sera pas corrigé tout de suite :D)
hey hey
si tu me connaissais
aussi bien que je te devine
oh
tu danserais
tu lancerais un chapeau dans les airs et nous tournerions
nous tournerions tu sais
en nous prenant par les coudes
et nos voix seront fausses
sur une mélodie invisible
peu importe
nous ririons de tous ceux qui riraient
de nous
et nous nous inclinerions devant eux
car nous sommes des bouffons
leur distraction éventuelle
juste le pur moment de joie
alors ivres nos sourires s'entrechoqueraient et
ils diraient
ils diraient
hey hey hey hey hey
aussi bien que je te devine
oh
tu danserais
tu lancerais un chapeau dans les airs et nous tournerions
nous tournerions tu sais
en nous prenant par les coudes
et nos voix seront fausses
sur une mélodie invisible
peu importe
nous ririons de tous ceux qui riraient
de nous
et nous nous inclinerions devant eux
car nous sommes des bouffons
leur distraction éventuelle
juste le pur moment de joie
alors ivres nos sourires s'entrechoqueraient et
ils diraient
ils diraient
hey hey hey hey hey
1.10.10
Lavalise (prologue)
Lavalise commençait sérieusement à en baver ; depuis le temps qu'elle se faisait traîner, qu'elle "roulait sa bosse" comme on dit... Ne lui restait plus qu'une petite moitié de roue difforme et douloureuse. Les trois autres, elles s'étaient tout simplement perdues, s'étaient peu à peu fondues dans la poussière pastel du chemin rose.
Lavalise, quand à elle, était grise.
Et l'homme devant, l'homme qui la traînait depuis tout ce temps, l'homme était blême et luisant de sueur, son costume blanc devenu quasi aussi rose que le reste.
Que le soleil c'est à dire.
Que le ciel.
Que les nuages presque rouges là-haut que
ce champ que ces blés que cette immense étendue d'épis qui - comme leur nom l'indique - vous épient. A longueur de journée.
L'homme aussi commençait à fatiguer, n'en pouvait plus de tirer cette valise boiteuse et lourde de souvenirs. Alors il la souleva et la cala sur son épaule. Et il reprit sa marche. Et Lavalise aurait pu se dire: Voilà, d'ici je ne crains rien. Comme un enfant voyant le monde du haut de son père. Dans la confiance. Dans la conscience d'être porté par un être plus fort que soi.
Voilà.
D'ici je ne crains rien.
Mais l'homme-fort, lui, craignait le soir ; il devait d'ailleurs le sentir venir, avec le vent qui poussait les nuages qui devenaient de plus en plus rouges. Il se mit soudainement à forcer le pas. Il paraissait tout occuper à espérer quelque chose: un endroit où dormir par exemple.
Heureusement pour lui, un bosquet d'arbres l'attendait plus en avant. Il accéléra encore et, lorsque la nuit tomba tout à fait (c'est-à-dire lorsque tout fut rouge comme le sang séché) ils étaient arrivés.
L'homme-crevé posa Lavalise sur un tapis de mousse et il s'assit à son tour. Il resta un long moment la tête basse, les bras croisés autour des genoux, essayant de calmer sa respiration. Et puis il s'allongea sur le côté et s'endormit.
Les valises, quant à elles - et tout le monde le sait - ne dorment pas: elles attendent. Elles sont des objets patients, pleins de mémoire et de linge froissé. Aussi attendit-elle le réveille de son maître, de son guide. Elle attendit toute la nuit, et, au petit matin, lorsque le rose revint à la cime des arbres, lorsque le soleil émergea et rebondit sur le sol dans un grand splach! avant de reprendre son envol, l'homme-dort était mort... et paisible comme jamais.
Lavalise aurait alors pu pleurer mais les valises - comme tout le monde le sait - ne pleurent pas non plus.
Elles attendent. Toujours.
Elles attendent une autre main qui les embarquerait un peu plus loin, loin de la mort, loin d'une respiration qui doucement disparaît, s'étiole, s'évapore emportant quelques secrets mal définis. Trop vagues. Donc impossibles à entasser.
Bref.
Lavalise connu pour la première fois la solitude. Et ses tissus devinrent chair, et, si elle avait pu, elle se serait cette fois mise à hurler. Comme ça. Comme pour accompagner les aigles fins à la sauce aigre-douce qui piaillaient dans le ciel.
Lavalise, quand à elle, était grise.
Et l'homme devant, l'homme qui la traînait depuis tout ce temps, l'homme était blême et luisant de sueur, son costume blanc devenu quasi aussi rose que le reste.
Que le soleil c'est à dire.
Que le ciel.
Que les nuages presque rouges là-haut que
ce champ que ces blés que cette immense étendue d'épis qui - comme leur nom l'indique - vous épient. A longueur de journée.
L'homme aussi commençait à fatiguer, n'en pouvait plus de tirer cette valise boiteuse et lourde de souvenirs. Alors il la souleva et la cala sur son épaule. Et il reprit sa marche. Et Lavalise aurait pu se dire: Voilà, d'ici je ne crains rien. Comme un enfant voyant le monde du haut de son père. Dans la confiance. Dans la conscience d'être porté par un être plus fort que soi.
Voilà.
D'ici je ne crains rien.
Mais l'homme-fort, lui, craignait le soir ; il devait d'ailleurs le sentir venir, avec le vent qui poussait les nuages qui devenaient de plus en plus rouges. Il se mit soudainement à forcer le pas. Il paraissait tout occuper à espérer quelque chose: un endroit où dormir par exemple.
Heureusement pour lui, un bosquet d'arbres l'attendait plus en avant. Il accéléra encore et, lorsque la nuit tomba tout à fait (c'est-à-dire lorsque tout fut rouge comme le sang séché) ils étaient arrivés.
L'homme-crevé posa Lavalise sur un tapis de mousse et il s'assit à son tour. Il resta un long moment la tête basse, les bras croisés autour des genoux, essayant de calmer sa respiration. Et puis il s'allongea sur le côté et s'endormit.
Les valises, quant à elles - et tout le monde le sait - ne dorment pas: elles attendent. Elles sont des objets patients, pleins de mémoire et de linge froissé. Aussi attendit-elle le réveille de son maître, de son guide. Elle attendit toute la nuit, et, au petit matin, lorsque le rose revint à la cime des arbres, lorsque le soleil émergea et rebondit sur le sol dans un grand splach! avant de reprendre son envol, l'homme-dort était mort... et paisible comme jamais.
Lavalise aurait alors pu pleurer mais les valises - comme tout le monde le sait - ne pleurent pas non plus.
Elles attendent. Toujours.
Elles attendent une autre main qui les embarquerait un peu plus loin, loin de la mort, loin d'une respiration qui doucement disparaît, s'étiole, s'évapore emportant quelques secrets mal définis. Trop vagues. Donc impossibles à entasser.
Bref.
Lavalise connu pour la première fois la solitude. Et ses tissus devinrent chair, et, si elle avait pu, elle se serait cette fois mise à hurler. Comme ça. Comme pour accompagner les aigles fins à la sauce aigre-douce qui piaillaient dans le ciel.
Inscription à :
Articles (Atom)